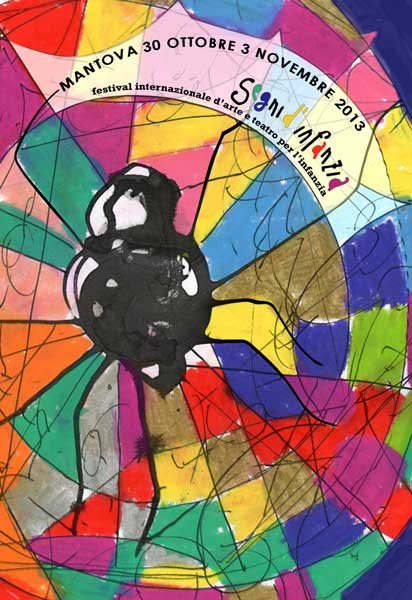Puis-je imaginer ma vie sans la danse ? Il m’arrive parfois de ressentir ce cauchemar, de paniquer à l’idée de ne plus rien écrire sur elle; de la laisser, pour me détourner de moi, de vous. Ce soir, Klap, Maison pour la Danse à Marseille, programme «Stimmlos» d’Arthur Perole. Trente kilomètres me séparent et je dois dépasser ma fatigue accumulée depuis 10 jours. Je ne le connais pas. Juste qu’il vit dans les Alpes-Maritimes, département du bout du bout où la danse cherche sa place au milieu du stress, des paillettes et des barres verticales…En silence…
Klap m’accueille. Mais auparavant, j’entre dans le noir inquiétant d’une rue où les ombres s’affolent au rythme des musiques entremêlées avant d’inhaler les fumées d’un public à l’entrée qui semble attendre le DJ ! A l’intérieur de Klap, l’atmosphère orangée du hall m’apaise. Dans quelques minutes, cinq danseurs étireront le temps, régleront la lumière sur l’aube, propulseront le plateau en terra incognita et m’immobiliseront dans une écoute sans limites.
Je comprends très vite que le silence provoqué par «Stimmlos» n’est pas décrété. Qu’il se fabriquera pendant cinquante minutes. Qu’il imposera le sens de l’art, même lorsque les sons de la rue tenteront de se faire entendre. Ici, le silence est une émergence du groupe, voire d’un gouffre d’où partent les effluves de nos terrains devenus trop marécageux, à force d’être piétinés bruyamment par nos pas insensibles. Le silence a sa lumière : un soleil levant, à peine couché, pour que la danse éclaire les ondes de danseurs magnétiques. Trois femmes et deux hommes m’invitent à ressentir le silence pour penser le corps ; à détourner le regard pour plonger dans les méandres de leurs gestes où la danse prolonge l’incertitude vers l’inconnu: avec eux, rien ne s’arrête, tout se faufile, défile, file, vers l’écoute.
Je ne cesse de créer mes dialogues intérieurs: lorsque Mathieu Patarozzi, homme peuplier, étire ses branches, disparaît dans son feuillage puis se courbe vers la terre tel un oiseau de bel augure, j’entends la forêt se peupler par la renaissance des quatre autres. Lorsque Steven Hervouet déploie peu à peu les ailes de sa danse vers l’envol de nos utopies, je l’entends qui s’approche du vide créatif créé par le quatuor. Lorsqu’Éva Assayas, Marie Barthélémy etAriane Derain étirent leurs corps pour creuser la profondeur du plateau, j’entends deux danseurs qui bâtissent l’espace pour que l’écho soit un mouvement vers nous…
Lorsque tout se fait entendre, «Préludes» de Richard Wagner poursuit la belle œuvre. Cette musique en habits noirs, éclaire les chemins complexes du silence où s’aventurent les danseurs avec élégance. J’y vais aussi. Lorsqu’on y est, Wagner se retire comme à marrée basse, laissant les danseurs pieds à terre, mains en l’air, bras en pinceau pour redessiner les corps pétris de silence. J’y suis, habité par tous leurs gestes. Par vague, j’entre et me retire. Je suis submergé par cette danse de l’écume d’où surgissent des tableaux qu’un vent wagnérien disperse au-delà du plateau pour propager le silence du beau.
Arthur Perole m’a relié à la danse de l’art. Je l’ai écouté comme rarement il m’a été donné de le faire. Cet artiste doit savoir ce qu’il en découle de proposer une danse où les ponctuations font la phrase, où le geste est un mot virgule.
«Stimmlos» est une grande œuvre de danse.
Klap, Klap !
Pascal Bély – Le Tadorne
« Stimmlos » d’Arthur Perole à Klap, Maison pour la Danse à Marseille, le 7 février 2014. Puis au Festival Faits d’Hiver à Paris les 10 et 11 février 2014.
Crédit Photos: Nina Flore Hernandez.