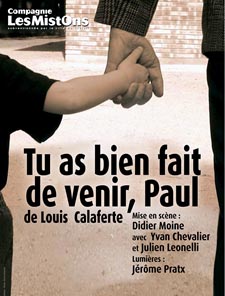Il est à mon sens le fort de l’intérêt dans cet espace d’exposition. Il était la rencontre que je souhaitais faire en ce lieu et c’est avec beaucoup d’émotion que j’ai rencontré l’univers de Tim Walker. Dans notre société, il est extrêmement difficile d’être un homme subtil, d’oser afficher ainsi sa sensibilité si enfantine, soutenue par une capacité à l’émerveillement. Les femmes adorent. L’inquisiteur masculin s’avance sans engouement, mais vite se laisse happer dans les clichés. Ici, “la Belle au bois dormant“plus vrai que le trait de crayon de Disney. Plus loin, les fées de cette dernière apparaissent toutes en robe dans un arbre. Là, la princesse au petit pois. Êtes-vous réellement une pure princesse des temps modernes ? Encore plus loin, des chats colorés. L’art touch de Warhol ou un clin d’?il d’Alice au pays des merveilles. Ou bien la voiture- cabane pour partir camper dans des contrées lointaines comme jadis.
On se sait plus bien si la subjectivité de ces photos n’intègre pas complètement une réalité, qui nous est si proche : notre enfance.
Le passé redevient présent avec tellement de bonheur. Tim Walker semble nous dire «plus tard quand je serai grand, je serai petite fille». Et ce n’est pas Bettelheim qui nous affirmerait le contraire.

Grand format. Portraits statiques des gardes militaires de différents corps armés étrangers. Au commencement de la rencontre avec l’artiste, on flotte dans le creux, on erre au milieu de ces immobilités sans réflexion. Et puis, l’oeil accroche d’un coup au jeu. On ne fait plus attention aux détails des costumes divers, mais au regard que chacun des sujets des clichés nous renvoie. Un pas à droite. Un pas à gauche. Piqué central. Nous sommes observés sans relâche. Il s’agit du jeu du regard de notre Joconde internationale! Et là, avec notre âme la plus naïve, nous jouons avec chacun des portraits. Bien vu Monsieur Freger !

Des cubes noirs et blancs. Une fenêtre brisée nous accueille à l’entrée avec un cliché en fond. Trois personnes. Deux femmes nettes et provocantes par leurs couleurs de maquillage ; un homme brouillé plus loin. L’avertissement est entendu : êtes-vous prêt à pénétrer dans cet espace, dans ce pays, dans cet appartement reconstitué ? Oui ? Alors bienvenue dans la vie à Saint-Pétersbourg, haut lieu de l’intelligentsia de la bourgeoisie russe du XIXème, qui se dévoile dans la décrépitude la plus significative, tentant de nous dire, « ici nous survivons, nous sommes les héritiers d’une nation. Nous n’attendons plus. Nous agissons, car nous vivons et vivre n’est-il pas le plus bel espoir qu’il soit.” Alors, on lave le linge avec Natacha qui part sa présence filmée réitère inlassablement le nettoyage. L’absurde de l’existence, faire pour refaire sans réalisation. Mais Natacha est une personne et non une notion.
Cube noir. Sa chambre. L’intime de Natacha. Elle est nue. Elle est vulgaire par l’attitude corporelle, tellement attachante. Elle est si femme. On se laisse croire en elle.
La cuisine, cube blanc. Digne d’un décor pensé par Emir Kusturiza. Chat blanc, chat noir. Je n’ai pu m’empêcher de rêver à la grandeur de cet ancien appartement qui avait dû connaître de la majesté en son temps. Les ruines de l’architecture en témoignent. Et là sous nos yeux, l’incohérence d’un bric-à-brac trahissant un inconfort que notre société réfute. En pensée, on s’insurge. On ne peut vivre ainsi. Mais l’existence propre d’une destinée se nourrit-elle de l’inconfort matériel ou de la construction d’une réflexion dans ce corps qui nous transporte ?

Il s’agit de clichés de mariage sur différentes époques. C’est l’expression du kitsch populaire. La représentation angoissante du bonheur. On hésite entre la dépression la plus noire et le rire du burlesque le plus fou. Je me suis mariée aussi un jour et ce qui s’étale sous mes yeux a justement été tout ce que je réfutais. De la photo dite stylisée par ces effets dégageant un avenir prédit, à la photo qui confirme que le ridicule ne tue pas, on promène dans l’institution du mariage. Monsieur Bourcart, je salue votre courage de croire encore que le mariage est le plus beau jour de notre vie.

Les écolières des régions limitrophes d’Anatolie orientale.
J’ai été saisie par le cinéma muet de cette jeunesse désolée de petites filles d’ailleurs. Les portraits en pied sont en noir et blanc et traduisent une époque que nous ne retenons plus grâce à la modernité de notre civilisation industrielle. Les regards sont durs et profonds, accusateurs et offrant leur tendresse. On s’avoue incrédule devant ce présent si passé dans nos mémoires. Le plus frappant saisit lorsque l’on se dit que ces jeunes pousses, âgées d’une décennie tout au plus, ont en charge un pari sur l’avenir. Celui du bonheur ? Mais lequel ?
Et c’est si seule avec mes pensées coupables de rien que j’ai laissé là ces gamines.

Vous serez beau, chic, délicat et facile à reconnaître.
Monsieur Fosso, vous êtes la mutation d’un même être en différents personnages. À croire que le fait d’un déguisement n’était pas assez intense à votre goût, que vous nous prouver que même nu nous pouvons être autre. Le “je” serais donc un autre ? Nous nageons en pleine anthropologie. Sauf qu’ici l’homme est étudié dans l’environnement d’un studio photo, où sa genèse semble s’identifier au travers des attitudes. Qui sommes-nous ? D’où venons- nous ? J’ai une vague impression de relire “Race et Histoire” d’un de vos collègues L.Strauss, fourvoyant nos idées préconçues. L’avez-vous donc lu aussi ?

Grand format environ 150×150. Portraits en couleur sur fond noir.
Pierre Gonnord travaille à la façon des portraits que faisait exécuter la bourgeoisie afin de conserver une haute estime dans les traces de l’Histoire. Le déclic de l’artiste traduit des icônes de sainteté, représentation différente de l’humanité où le plus criant est le portrait de l’aveugle. Il nous intime l’ordre de regarder, afin d’y voir la vérité de ce que nous sommes. Une humanité qui voyage toujours en quête de sa réalité. Rembrandt aurait trouvé ici un héritier dans les visions de son époque.